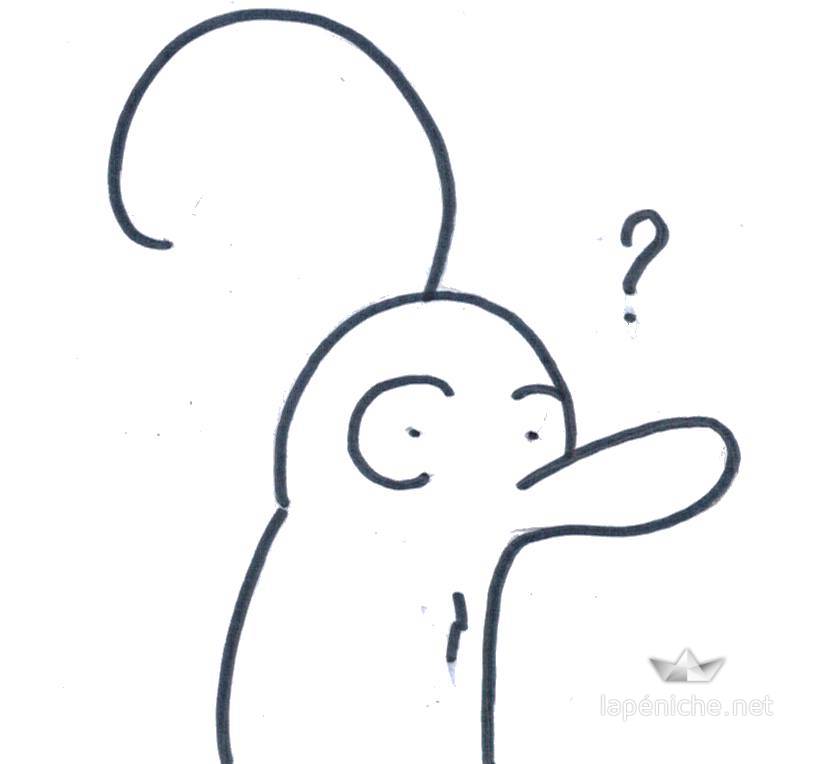Vingt ans après sa mort, que reste-t-il de Mitterrand ? Entretien avec Michèle Cotta
A l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de François Mitterrand, le 8 janvier 1996, s’intéresser au bilan de celui qui a exercé la fonction présidentielle pendant quatorze ans revient aussi à se pencher sur l’héritage qu’il a laissé à gauche.
La journaliste Michèle Cotta a commencé à suivre Mitterrand à partir de 1965, lors de son arrivée au magazine L’Express. Elle a assisté aux grandes étapes de l’histoire du PS : le rapprochement avec les communistes à travers le Programme commun en 1972, l’éclatement du Programme commun en 1977, l’élection victorieuse de 1981, le changement de politique économique en 1983… Dans sa ville natale de Nice, rencontre avec la présentatrice de deux débats de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, en 1981 et 1988…face à François Mitterrand.
Sa marque dans l’histoire politique française
Qu’a représenté François Mitterrand ?
D’abord une autorité. Une autorité qu’il a exercée en tant que président de la République, bien sûr, mais qu’il a d’abord démontrée en faisant l’unité de la gauche. Mitterrand a réussi à rassembler la gauche socialiste, la gauche chrétienne, puis les communistes qu’il a mis au gouvernement. Il lui a fallu beaucoup de temps, car la gauche a toujours tendance à se diviser, mais il a réussi.
Et au-delà de l’autorité ?
Ce qui marque c’est aussi la profondeur du personnage. Il aimait la littérature, en était nourri, ce qui a complètement disparu de la politique actuelle. C’est un polémiste né, avec un grand talent littéraire et une large connaissance de l’histoire de France.
Et puis François Mitterrand représente une conception particulière du socialisme. Il a été le premier à dire, alors qu’il était Président, que « le socialisme, [il] n’en fais[ait] pas [s]a bible ». Il avait une conception humaniste du socialisme, plus qu’économique et marxiste.
« François Mitterrand a incarné une autorité, une profondeur culturelle et un socialisme humaniste »
Justement, comment définir précisément « son » socialisme ?
C’est un socialisme humaniste peu sectaire, et assez opportuniste. Quand il s‘aperçoit que la ligne économique n’est pas la bonne en 1983 – après les nationalisations, la relance par la consommation, l’abaissement de la durée de travail, etc. -, il en change complètement (c’est le « tournant de la rigueur », NDLR). En fait il est réaliste, plus qu’opportuniste, ce qui fait qu’on peut se demander si à la fin de sa vie il était aussi socialiste qu’au début. Il était simplement pragmatique, c’est-à-dire social-démocrate.
Quelles valeurs tenait-il pour essentielles ?
La justice et l’égalité. Pour lui, il n’y a pas de système social possible s’il n’y pas une ambition de justice. C’est ça son socialisme, et non pas l’idée marxiste que la puissance publique doit disposer des moyens de production. Il n’a jamais été marxiste, ça c’est sûr.
« Mitterrand était social-démocrate. […] Il n’a jamais été marxiste »
Ses relations avec le Parti communiste français
S’il s’est allié avec le Parti communiste français (PCF) à travers le Programme commun de 1972, c’est donc purement par intérêt, par stratégie ?
Pas par intérêt personnel, mais par stratégie. Il pensait que tant que la gauche était divisée, entre un PCF qui faisait 25% des voix et une gauche socialiste qui en faisait 15%, les socialistes n’avaient aucune chance d’accéder au pouvoir – et les communistes non plus d’ailleurs. S’il a été obligé d’accepter certaines choses avec le PCF, il l’a dit lui-même, c’était pour le réduire et pour gagner. Cela a été sa constante absolue.
C’est cette stratégie qui explique sa victoire en 1981 ?
Oui, et c’est aussi les difficultés idéologiques rencontrées par la gauche de la gauche, affaiblie pendant les années 70. Ça a aidé Mitterrand que les communistes finissent par abandonner le Programme commun en 1977, car d’une certaine manière ça le libérait d’eux. De 1972 à 1977, il a donc réussi à imposer sa stratégie complexe et à affaiblir le PCF en s’en rapprochant.
Et puis il y avait une désaffection du PCF en 1981. Alors que dans les années 70, tous les intellectuels adhéraient au communisme, beaucoup s’en détournent après le tournant de Soljenitsyne (écrivain russe qui publie en 1973 L’Archipel du Goulag, dans lequel il décrit le système concentrationnaire de l’URSS, à une époque où il y a un déni sur cette question, NDLR). Cela a été très important pour Mitterrand, qui a alors pu récupérer des déçus du communisme, et même des trotskistes et des gauchistes.
Ses relations avec le Front national
A-t-il tenté d’utiliser Le Pen pour diviser la droite, comme on l’entend souvent ?
Je ne dirais pas qu’il a tenté de l’utiliser. D’abord il ne pensait pas que Le Pen ferait autant de voix, il pensait que l’extrême droite n’avait pas d’avenir. Il s’est trompé. Mais ces quelques pourcentages étaient autant de voix pris à la droite classique. Il n’a pas monté en épingle Le Pen, il a juste pris acte de son ascension. Mais c’est sûr que ça l’a arrangé.
Un parcours irrégulier
De 1946 à 1958, sous la IVe République, François Mitterrand est à la tête d’un petit parti rassemblant des gens du centre-gauche et du centre-droit, avant de fonder le Parti socialiste en 1971. C’est un virage idéologique ?
Son itinéraire est intéressant, il n’est pas linéaire. Mitterrand était plutôt à droite au départ, mais anti-gaulliste. Il ne se retrouvait dans aucun des trois principaux partis de la IVe République (MRP au centre-droit, communistes, socialistes). Donc il cherchait une autre voie et a vraiment voulu créer un parti indépendant et charnière, l’UDSR.
Quand et pourquoi est-il arrivé à gauche ?
C’est à cause du radical-socialiste Pierre Mendès-France, alors président du Conseil : Mitterrand approuve sa politique de décolonisation en 1955 au Maroc et en Tunisie. Il y a un tournant à gauche qu’on ressent très bien à ce moment là.
Comment expliquer qu’il est sensible au discours de décolonisation de Mendès-France, alors qu’en 1954, il déclare que « l’Algérie, c’est la France » ? C’est un autre basculement ?
Quand il dit ça il est ministre de l’Intérieur, l’Algérie est alors un département français: je ne vois pas ce qu’il aurait pu dire d’autre. En revanche, après les négociations menées par Mendès-France, il a été partisan d’une décolonisation intelligente. C’est un grand tournant dans sa vie que je situe donc en 1954-1955. Il y a une constante à partir de là dans son socialisme humaniste. Puis De Gaulle est revenu en 1958, et la seule façon de conquérir son « territoire politique » était de « gravir la montagne » par la face gauche alors que De Gaulle la montait par la face droite.
« Il arrive à gauche en 1955, car il approuve la politique de décolonisation de Mendès-France. Il y a une constante à partir de là dans son socialisme humaniste »
Comment parler de « constance » idéologique alors qu’il passe d’un discours sur « l’argent qui corrompt » en 1971 au « tournant de la rigueur » en 1983, ensemble de mesures économiques libérales qui marquent la conversion de la gauche gouvernementale à l’économie de marché ?
Non, il n’a pas changé. D’abord, quand on fait une campagne à gauche et qu’on dit qu’on aime l’argent, ça ne marche pas. Et puis il a ce sentiment de justice en lui qui prévaut et qui est spontanément hostile aux riches, aux thésaurisateurs, à ceux qui s’enrichissent en dormant. C’est insupportable pour lui.
« Il n’a jamais voulu abattre la structure du capitalisme en France »
Mais on sait qu‘une fois qu’on arrive au pouvoir, il faut bien traiter les grandes entreprises du CAC40. Le problème des entreprises est important en France et c’est le problème actuel : pour faire bouger la gauche de ce côté là, il a fallu du temps. Il n’a jamais voulu abattre la structure du capitalisme en France, malgré ses nationalisations, qui étaient les premières en France depuis De Gaulle, et qui n’ont pas duré longtemps puisque ses successeurs sont revenus dessus.
Il a compris qu’il fallait gouverner selon la social-démocratie, mais ce n’est pas exactement une mue chez lui. Il s’est servi des communistes, mais il a toujours été social-démocrate à partir du milieu des années 1950. Je n’ai jamais vu de virage.
Donc le « tournant de la rigueur » porte mal son nom ?
C’est un tournant économique, mais pas idéologique pour lui. Il voyait bien que la politique économique allait droit dans le mur. C’est tout à fait pragmatique, la social-démocratie est pragmatique.
Il a fait preuve de continuité en prenant le pouvoir avec les communistes et en l’exerçant comme prévu avec eux. Et quand il a fait la preuve que ça ne marche pas, il change. C’est une trajectoire, et non un virage.
« Le tournant de la rigueur est économique, pas idéologique ; c’est une trajectoire, pas un virage »
Des modèles puisés dans la littérature, pas dans la politique
Quels étaient les mentors de Mitterrand en politique ?
Il n’en a pas, et c’est intéressant car c’est très rare. Tous les hommes politiques ont une sorte de héros : Clemenceau pour Valls, Blum pour Fabius, d’autres disent Jaurès ou De Gaulle. Mitterrand ne s’assimile à personne. Et la seule fois où il voit De Gaulle, pendant la guerre, quand il a 26 ans, il trouve le moyen de s’embrouiller avec lui.
Peut-on dire que ses mentors étaient les écrivains qu’il appréciait ?
On peut dire ses « références littéraires », mais en tous cas il n’y a pas de mentor politique dans lequel il se reconnaisse.
Quels hommes politiques manient aujourd’hui la langue comme il le faisait ?
Il y avait Edgar Faure (président du Conseil en 1952 puis 1955-1956, NDLR) qui est mort, mais il n’y en a plus.
Vous le déplorez ?
Non, je le constate. C’est vrai que toutes les promotions de l’ENA ne font pas des historiens ou des écrivains. Parce qu’on y apprend des tas de choses mais pas la littérature, et l’histoire c’est le strict minimum.
1981 et 2012 : miroir fidèle ou reflet inversé ?
Peut-on comparer la ferveur qui a suivi l’élection de Mitterrand en 1981 à celle qui a suivi celle de Hollande ?
Non, ça n’a rien à voir.
Il n’y avait pas de désir de gauche en 2012 ?
Il y avait un désir de faire partir Nicolas Sarkozy. Mais certains ont aussi dit que Mitterrand avait été élu par refus de Giscard. C’est assez français : les gens arrivent au pouvoir par refus des personnes qui dirigent.
Quelle différence alors ?
La différence, c’est qu’en 1981, personne ne pensait que Mitterrand allait gagner : les sondages étaient bons pour Giscard jusqu’au dernier moment. Pour Hollande c’est le contraire : les sondages étaient formidables depuis le début pour lui.
« L’élection de 2012 s’est faite sans cet espoir incroyable qu’il y avait en 1981. Et sans cette espèce de peur aussi »
Donc l’élection de 2012 s’est faite plus naturellement, avec une mobilisation, certes, mais sans cet espoir incroyable qu’il y avait en 1981. Et sans cette espèce de peur aussi, puisque personne n’avait peur de la gauche socialiste, surtout pas de la gauche de Hollande. Je me souviens en 1981 de gens de droite qui me disaient : « attention, il va y avoir les chars soviétiques dans Paris. » Ce qui m’a toujours fait rire puisque Mitterrand ne se reconnaissait pas dans les communistes.

Les punchlines de François Mitterrand (à retrouver dans le livre de Michèle Cotta Le Monde selon Mitterrand, Tallandier, 2015)
- En 1945, avant de fonder l’UDSR : « J’ai quelque tentation politique. J’adhèrerais bien au parti SFIO, mais il rassemble tant de vieilles cloches ! Les communistes m’embêtent. Les autres sont des jean-foutre. Reste l’inconnu ! »
- En 1951, à la tête de l’UDSR : « Socialisme moderne, oui : libéralisme politique, oui. »
- En 1971, à la tête du PS : « l’argent qui corrompt, l’argent qui achète, l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes ! »
- En 1976 : « Ma grande chance historique, c’est l’incroyable médiocrité des dirigeants communistes. (…) On peut les manipuler comme on veut. Ils sont tous plus bêtes les uns que les autres. »
- En 1981 : « Je me sens social-démocrate, c’est-à-dire que je ne tente jamais une réforme lorsque je suis sûr qu’elle échouera. »
- Sur les énarques : « Conformistes, incapables d’écrire en français, coupés du peuple, réactionnaires. »
- Sur ses livres de prédilection : « Si vous étiez obligés de partir à la guerre, quel livre emporteriez-vous dans votre musette ? – Pensées de Pascal, Abbaye de Thélème de Rabelais. »
- Sur la vie (à une journaliste, en 1979): « Vous ne parlez que de politique, mademoiselle ? Vous n’aimez pas la vie ? »