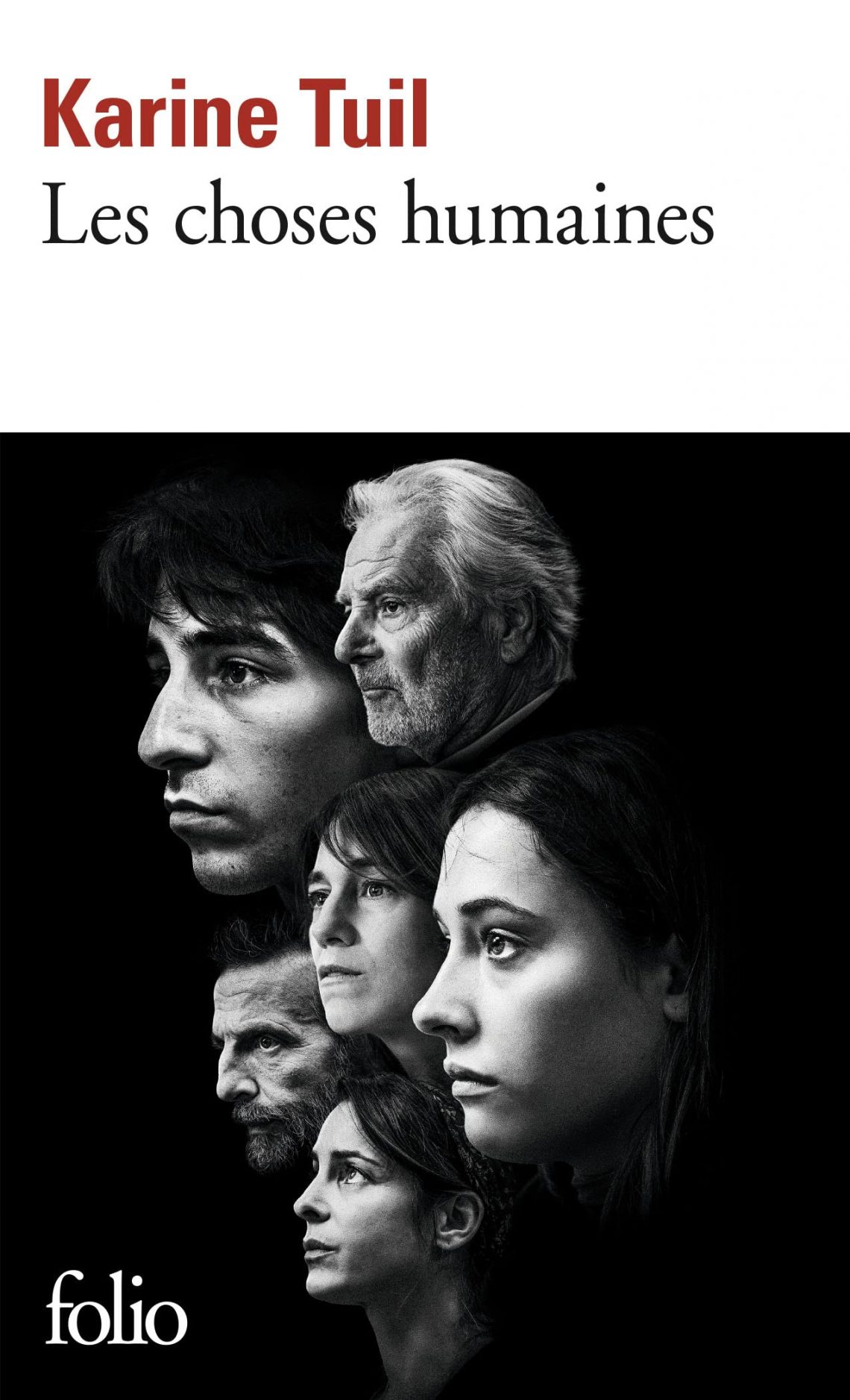
Avec Les choses humaines, Yvan Attal propose une adapation décevante du roman de Karine Tuil
“La société malade du viol ne peut guérir que si, en ayant fait le diagnostic, elle accepte de remettre radicalement en question les grands rouages de sa machine culturelle, et son contenu. », écrit Gisèle Halimi dans Le crime. Avec son nouveau film, “Les choses humaines”, Yvan Attal déploie une réflexion sur la mécanique sociale du viol et la notion de consentement. Mais la légitimité du sujet cache une pâle adaptation du roman de Karine Tuil paru en 2019 et lauréat du prix Goncourt des lycéens. Dès lors, se confronter à des sujets importants ne suffit pas à réaliser un film de qualité.
Etudiant dans la très prestigieuse université de Stanford aux Etats-Unis, Alexandre Farel revient à Paris pour passer un peu de temps avec sa famille qui incarne le stéréotype de l’élite bourgeoise et intellectuelle. Son père est un journaliste à succès et sa mère une essayiste féministe. Il rencontre le nouveau compagnon de sa mère qui a une fille, Mila. Après une soirée, Mila accuse Alexandre de viol. S’ensuit alors un procès qui confronte deux visions sur le consentement: pour Mila, il y a eu viol et, pour Alexandre, il s’agissait d’une relation sexuelle consentie. Il se réfugie derrière la justification de la “zone grise” afin de se dédouaner de tout crime. La dernière partie du film épouse la dynamique du procès de l’accusé et met le spectateur dans la peau et dans les interrogations d’un juré: comment trancher sur la question du consentement en aboutissant à l’émergence d’une vérité judiciaire imparfaite ?
Le film souffre de la comparaison avec le roman de Karine Tuil
Le film d’Yvan Attal est beaucoup moins riche que le roman de Karine Tuil, même s’il est fidèle aux grandes lignes de l’intrigue.
Contrairement au roman, certains personnages sont vidés de leur substance et réduits à des archétypes peu nuancés. Pour un film qui surfe sur la vague féministe du mouvement MeToo, les personnages féminins sont paradoxalement les plus creux. Yvan Attal expédie le casquette d’essayiste féministe de Claire dans une scène caricaturale qui met en tension, à propos des agressions sexuelles de Cologne, les éléments de langage du féminisme universaliste et d’un féminisme plus intersectionnel accusé de privilégier l’antiracisme à l’antisexisme. De même, l’écartèlement moral de Claire entre ses engagements d’essayiste et son statut de mère d’un violeur présumé est peu approfondi. Mais c’est surtout le traitement du personnage de Mila qui est purement et simplement bâclé par le réalisateur. Jamais l’environnement religieux et rigoriste dans lequel elle évolue n’est questionné et creusé. Même si le livre se plaçait avant tout du point de vue d’Alexandre, Karine Tuil donnait une certaine épaisseur dramaturgique à Mila qui réussissait à ne pas se résumer à son statut de victime en dépassant le conservatisme religieux de sa mère. Le film délaisse certains éléments du livre qui auraient pourtant permis d’affiner le personnage de la mère de Mila: sa fille est une rescapée de la tuerie de Merat à l’école juive de Toulouse et elle se referme depuis sur la sphère de la foi. C’est surtout Alexandre qui bénéficie d’intrigues secondaires. L’on peut alors mettre en avant l’hypothèse du népotisme pour expliquer ce traitement différencié. Yvan attal a en effet fait tourner sa femme (Charlotte Gainsbourg) et surtout son fils (Ben Attal) qui incarne Alexandre. En neutralisant l’arc narratif de Mila présent dans le roman, il donne à son fils le rôle le plus important et le plus nuancé.
De multiples réflexions sont abandonnées à l’écran comme l’impact des réseaux sociaux dans une affaire de viol ou encore le dédoublement de la violence avec la confrontation entre deux classes sociales. La tension sociale se résume à l’opposition entre Alexandre – ancien d’Henri IV, amateur de champagne de luxe et qui brille dans la maîtrise de la rhétorique – et Mila, dont l’identité sociale n’est pas brossée: cela témoigne encore du fossé qui sépare ces deux personnages dans le travail scénaristique.
La légitimité du propos ne sauve pas les faiblesses artistiques du film
La réflexion que mène Yvan Attal sur la notion de consentement est très intéressante mais elle est parasitée par les faiblesses artistiques du film. De fait, il sacrifie la qualité de son film (scénario, direction des acteurs et mise en scène) sur l’autel d’un sujet important qui lui accorde nécessairement une attention médiatique et un bouclier moral contre les critiques.
Dans ce casting 5 étoiles, ce sont les plus jeunes et les moins expérimentés qui s’en tirent le mieux (Ben Attal et Suzanne Jouannet). Les acteurs confirmés brillent peu. L’on a connu Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg et Kassovitz bien meilleurs. À ce titre, la scène dans laquelle Claire – jouée par Charlotte Gainsbourg – apprend l’identité de l’accusatrice de son fils et manifeste sa stupéfaction à coup de mimiques surjouées est très gênante. Arditi incarne lui le père d’Alexandre, avatar d’un DSK libidineux drogué au Prozac, cliché du mâle blanc sexiste perpétuant la culture du viol, et dont la liaison avec une stagiaire intéresse peu le spectateur. Notons aussi la présence de Laetitia Colombani, l’autrice de La Tresse, qui peine à convaincre dans son rôle de psychologue.
Dans L’OBS, le critique François Forestier résume très bien le problème de ce film: “Du cinéma de bon élève, intéressant mais jamais enthousiasmant”. En s’inscrivant dans la vague de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, Yvan Attal propose un film qui prend à bras le corps un grand sujet de société. La partie sur le procès est ,à ce titre, passionnante et la fin rondement menée: elle dissipe finement le doute sur ce qui s’est passé durant cette soirée. Il s’agit donc d’un film propice à des débats féconds, intéressants et nécessaires, comme ce fut le cas lors de la table ronde organisée par Sciences Po le premier décembre dernier. Mais cela en fait-il forcément un film de qualité ? Yvan Attal ne fait pas grand chose de la richesse du scénario, prémâché par le roman de Karine Tuil. La manière dont il met en scène le procès est trop appuyée et pompeuse, entre gros plans et travellings vertigineux. À titre de comparaison, un film comme La fille au bracelet de Stéphane Demoustier était plus convaincant dans les scènes de témoignages et de plaidoiries lors d’un procès.
Malgré ses défauts – notamment une introduction trop mécanique des personnages -, le roman de Karine Tuil possédait un vrai souffle et un vrai ryhme. En aplatissant la structure du roman en trois parties simplistes (histoire d’Alexandre, histoire de Mila puis le procès), le film d’Yvan Attal ennuie durant toute sa première moitié. Aveuglé par la légitimité de son sujet, il semble avoir oublié qu’un film se juge aussi sur ses qualités artistiques.
Karine Tuil a puisé son titre, “les choses humaines”, dans le premier volet de La Recherche de Proust. L’on peut alors penser à une réflexion du narrateur proustien exposée dans La prisonnière: une oeuvre d’art sur laquelle on retrouve des théories purement didactiques est comme un cadeau sur lequel on oublie d’enlever le prix. En d’autres termes, c’est du mauvais goût qui gâche l’oeuvre. C’est exactement ce qui se passe avec Les choses humaines d’Ivan Attal qui n’est pas un grand film mais un simple exposé rigoureux sur la question du consentement.

