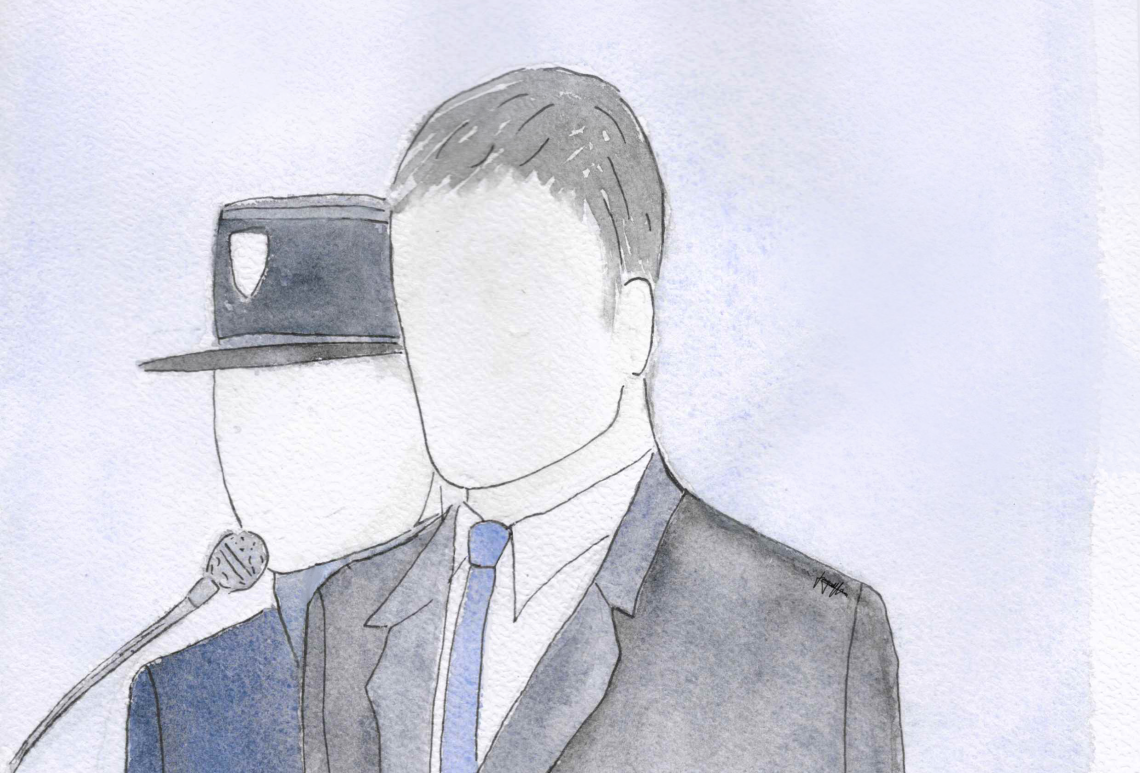
Le Procès Goldman, autopsier l’insubordination
Amiens, Cour d’Assises de la Somme. Le tumulte qui s’élève de la salle d’audience voit s’affronter les « Goldman, assassin ! » aux « Police assassin, justice complice ! ». Nous sommes en 1976, année où se déroule le deuxième procès du militant d’extrême gauche Pierre Goldman. Deux ans auparavant, ce dernier fût condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée et pour homicide volontaire des deux pharmaciennes du 6 Boulevard Richard Lenoir. Or, si Goldman reconnaît sa responsabilité dans les cambriolages, il nie farouchement être le meurtrier des deux femmes : « gangster », oui, mais « assassin, certainement pas ».
C’est ainsi au cœur de ce procès historique et politique que Cédric Kahn plante le cadre de son 13ème long-métrage, présenté en ouverture de la Quinzaine des Cinéastes. Le titre, « Le Procès Goldman », est révélateur : ce n’est pas à travers un biopic que nous découvrirons cette figure aussi charismatique que complexe qu’est Goldman. À la manière du mystérieux Thomas (Anthony Bajon) dans « La Prière », à aucun moment la trajectoire du personnage ne nous sera racontée ; pas de flashback, nous serons plongés in medias res dans l’audience, à la manière d’un juré qui ne dispose que du temps limité du procès pour appréhender le cas du militant d’extrême gauche.
Dans ce huis-clos, Kahn place au cœur de sa mise en scène la parole, dont la théâtralité est poussée à son paroxysme par le cadre du procès. Pendant presque deux heures s’enchaînent témoignages, plaidoiries et alibis dans une description quasi-chirurgicale des faits, chaque nouvel argument semant à nouveau le doute dans les convictions fragiles du spectateur. Cette centralité du verbe dans Le Procès Goldman prend ses racines, tout d’abord, dans le cheminement littéraire de Kahn vers la figure de Goldman. C’est à sa « fascination » pour l’ouvrage « Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France » – ouvrage rédigé par Pierre Goldman en prison – que le réalisateur attribue sa volonté de réaliser un long-métrage à ce sujet. Ensuite, ériger la parole en enjeu principal de son film constitue en soi un véritable défi de mise en scène. L’absence de musique, l’unité de lieu ainsi que le choix d’acteur.ices peu connu.e.s du grand public sont tout autant de facteurs qui contribuent à l’expérience immersive du procès que nous propose Cédric Kahn. De fait, le réalisateur et sa coscénariste Nathalie Hertzberg ont minutieusement reconstruit la structure du véritable procès en épluchant les journaux de l’époque. Davantage que de l’écriture, c’est à un travail de « sculpture » que se sont livrés les deux co-scénaristes ; à partir d’un matériau journalistique, le défi reposait sur la sélection et l’ordonnancement des prises de parole. De cette écriture au cordeau ressort un film quasi-documentaire, devant lequel il est difficile de deviner ce qui relève d’une infidélité à l’histoire (Christiane, compagne de Goldman, n’était pas présente au procès) ou d’une restitution minutieuse.
Au-delà de son dispositif de mise en scène, Le Procès Goldman intéresse pour la réflexion – aussi bien historique que politique – qu’il porte sur la société française. En effet, au fur et à mesure de la confrontation des témoignages se dévoilent l’antisémitisme latent et le racisme avéré d’une partie de la population, reconduit par les méthodes de l’institution policière. Et si Le Procès Goldman se donne pour objectif premier de restituer le climat des années 70, on décèle dans certaines joutes, dans la représentation de plusieurs France qui ont du mal à cohabiter – l’intelligentsia gauchiste s’opposant aux « bons français » plus conservateurs – une résonance politique dont l’actualité n’est jamais forcée, mais bien réelle. Et, de l’examen de la complexité de Pierre Goldman émerge une réflexion sur ce que cela signifie d’être un enfant de la Shoah. Si Goldman conçoit l’utopie révolutionnaire comme moyen de s’élever à la hauteur de l’histoire de ses parents, son avocat Kiejman (incarné avec justesse et intelligence par Arthur Harari) fait preuve d’une résilience qui contraste avec la figure du « juif maudit » de son client, leur tandem illustrant la difficulté à s’approprier cet héritage tragique.
Enfin, l’antagonisme Kiejman/Goldman se reconduit dans leur différend sur la stratégie à adopter, bras de fer portant en lui-même la réflexion du film sur le monde judiciaire. Goldman, arrogant et provocateur, considère en effet que les faits ontologiques seront sa meilleure défense : « Je suis innocent parce que je suis innocent ».
Certes, « but that’s not the point », pourrions-nous lui répliquer, pour citer une réplique prononcée par Swann Arlaud, incarnant l’avocat défense dans le palmé Anatomie d’une Chute.
En effet, on ne peut s’empêcher au visionnage de penser au film de Justine Triet : au-delà de la coprésence d’Arthur Harari (acteur chez l’un, au scénario chez l’autre) et du décor de la salle d’audience, nous faisons face dans les deux longs-métrages à des accusés ambigus et opaques. La complexité de la figure de Goldman (brillamment interprété par un Arieh Worthalter aussi irritant que charmeur), telle Sandra chez Triet, nous fait prendre conscience de l’inévitable subjectivité dans la décision de croire, ou non, à leur culpabilité. Les deux films placent au cœur de la justice non pas l’identification de la vérité mais plutôt la construction de jugements toujours partiaux. En effet, si disséqués, si autopsiés soient les faits dans les deux procès, le spectateur demeure contraint de se ranger à une opinion dont il ne peut savoir la véracité. Kahn comme Triet mettent en scène la puissance de la parole, mais aussi la fragilité du jugement : si procédurale et scientifique se veut être le monde judiciaire (l’expertise balistique du Procès Goldman faisant écho à la reconstitution numérique de la chute d’Anatomie), il demeure bien une affaire humaine. Dans toute décision de croire ou ne pas croire réside une subjectivité ; d’ailleurs, Cédric Kahn échoue lui-même à dissimuler son intime conviction.
Malgré ses précautions pour préserver l’ambiguïté autour de la culpabilité de Goldman, le simple fait que les seules sorties du huis-clos que s’autorise Kahn se déroulent auprès de Kiejman et Goldman portent intuitivement le spectateur à leur faire confiance, davantage qu’à un procureur (excellent Nicolas Briançon) franchement hostile. Mais, le sous-texte du film étant de nous rappeler que l’impartialité parfaite n’est qu’un idéal, peut-être est-ce un aveu de clairvoyance de la part du réalisateur de nous livrer son point de vue ; cela n’empêche pas le spectateur de se forger sa propre vérité, vérité toujours érigée sur la base du doute.
* Les extraits cités entre guillemets sont tirés d’une interview donnée par Cédric Kahn à la Quinzaine des cinéastes, disponible sur Youtube
Illustration : Alysse Verron

