La semaine cinéphile du Mag’ #7
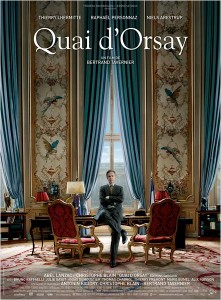
Jeux de mains, jeux de Villepin.
Quai d’Orsay, de Bertrand Tavernier
Alexandre Taillard de Vorms est grand à la crinière argentée, hystérique, fan des bons mots d’Héraclite (qu’il stabilote de façon compulsive) et chef de la diplomatie française. Quand le jeune Arthur Vlaminck est recruté au Quai d’Orsay par ce flamboyant ministre pour s’occuper des « langages », il ne sait pas où encore il met les pieds. Mais il va devoir s’accommoder d’une meute de conseillers, de coupes permanentes dans ses discours, de pluies de remarques contradictoires et des illuminations de son patron car l’Assemblée Générale de l’ONU approche et le ministre veut frapper fort. L’histoire se finit ainsi sur le fameux discours contre l’intervention au Lousdem. Voilà le pitch de « Quai d’Orsay », BD à succès de Blain et Lanzac, adaptée en film par Bertrand Tavernier qui réalise ici sa première comédie. Evidemment, Taillard de Vorms est en fait Villepin, le Lousdem est l’Irak et les Américains sont les Américains.
Retrouvons donc Thierry Lhermitte en Taillard de Vorms, Raphaël Personnaz en jeune diplomate tombé du nid et Niels Arestrup en dir’cab qui en a vu d’autres. Il vole d’ailleurs la vedette aux deux premiers par son don comique de supporter, avec un flegme inouï, le ministre bruyant et à la limite du supportable. On nage en plein burlesque, les gags sont visuels et plutôt bien ficelés, même si Lhermitte pourrait se lâcher un peu plus. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’Abel Lanzac (pseudonyme d’Antonin Baudry), l’auteur de la BD fut dans le costard de Vlaminck et sait donc de quoi il parle. Se pose donc en surimpression une vision assez hallucinante de ce que sont les coulisses de la diplomatie française, à quoi ressemblent réunions de conseillers et bruits de couloirs, joggings ministériels et remaniements de discours. Tout est dans le rythme, saccadé, effréné. « Il faut éteindre la démesure plus encore que l’incendie » disait Héraclite ou Villepin, on ne sait même plus.
Finalement, quand on se dit qu’en voyant le film, Dominique de Villepin aurait déclaré « c’est tout à fait ça, même un peu en dessous de la réalité », on est en droit de se demander le nombre de conseillers aujourd’hui en dépression, en asile ou cocaïnomanes par sa faute.
Hadrien Bouvier
Un train et des fantômes.
Le Transperceneige, de Bong Joon-Ho
Le réalisateur coréen Bong Joon-Ho, à qui l’on doit notamment Memories of Murder et The Host, s’attaque à la BD culte Le Transperceneige, de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Si un titre redondant et une bande-annonce très Hunger Games laissent présager le pire, Snowpiercer se révèle être un chef d’œuvre pessimiste et violent, offrant un regard ironique sur les révolutions.

En 2014, des scientifiques un peu givrés déraillent complètement et enrayent le réchauffent climatique à coups de refroidissants chimiques. Du coup dix-sept ans plus tard, forcément la terre est plus glaciale qu’une poignée de main Copé-Fillon et toute l’humanité repose six pieds sous neige. Toute ? Non ! Un convoi peuplé des derniers hommes résiste encore et toujours à la nouvelle ère glaciaire, en tournant inlassablement autour du globe à raison d’une boucle par an. A son bord, pas question de déroger au train-train quotidien imposé par le propriétaire et constructeur du train, l’industriel Wilford (Ed Harris). La locomotive est occupée par le dictateur et guide suprême du convoi et la sacro-sainte machine inépuisable qui motorise le train, les wagons de têtes par l’élite de cette mini-société autarcique tandis que la plèbe est parquée dans les compartiments de queue, opprimés par la milice et enfermés dans des conditions extrêmes, qui iraient jusqu’à approcher l’horreur de la ligne 13 un soir de match au Stade de France. Sans surprise, les passagers mécontents galèrent à contacter la direction de la RATP, et décident donc, emmenés par le sombre Curtis (Chris Evans) d’aller râler en tête de train.
Snowpiercer , c’est l’histoire de cette rébellion pas comme les autres. Par un huis-clos constant, une continuité narrative parfaite (aucun flashback, aucune ellipse) et un enchainement à couper le souffle de scènes hyperviolentes et de wagons d’un calme délicat, Bong Joon-ho installe une tension constante et captivante. Enfin, il fait apparaitre les contradictions de la révolte, montrant que perversion et cruauté ne sont pas l’apanage que d’un seul camp, et qu’elle n’a pas toujours l’origine que l’on croit. Complexe, violente et indécise, elle est peut-être comme les autres, cette rébellion. Poignante.
Barnabé Tardieux
« The Folk Singer »
Inside Llewyn Davis, de Joel et Ethan Coen
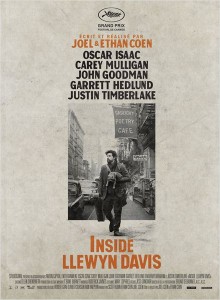
Les frères Coen aiment les losers. Et, allez savoir pourquoi, les losers des films des frères Coen, nous on aime aussi. D’autant plus lorsque le loser en question est interprété par un acteur comme Oscar Isaac. Il joue ici Llewyn Davis, un chanteur-guitariste de folk cherchant à se faire une place, ou simplement à gagner sa vie, dans le New York du début des années soixante. Sa guitare, c’est son boulot, les bars enfumés de Greenwich Village, sa scène. Il refuse de retourner dans la Marine, de finir comme son père. Il accompagne un groupe pour une chanson plutôt commerciale, « Please Mr Kennedy », on lui propose de signer pour les futurs droits d’auteur ? Non merci, il a besoin de cash, et de toute façon la chanson n’est pas terrible (finalement gros tube). Sa meilleure amie lui en veut à mort, son vieux directeur de label l’arnaque, même le chat profite de la moindre occasion pour lui faire faux bond. Décidément, rien ne lui réussit. Un jour, il entend parler de quelqu’un qui cherche un covoiturage pour Chicago, alors il fonce. L’occasion pour lui de rencontrer un grand nom de la musique à qui son manager a envoyé son disque quelques semaines plus tôt. On ne vous racontera pas la fin du voyage à Chicago, mais finalement, les moyens d’y parvenir seront bien plus drôles que le but lui-même (Ulysse et l’Odyssée ?).
La lumière est belle, les acteurs très bons, et la musique finit de nous transporter dans l’Amérique des années soixante. Même Bob Dylan est là. On pourra le comparer à n’importe lequel des quinze premiers films, évidemment, c’est du Coen. On reconnaît les ingrédients : humour noir et décalé, personnages atypiques et souvent solitaires, néanmoins filmés avec une certaine distance. L’ambiance aussi : climat rude, lumière sombre, et, pour adoucir le tout, de la bonne musique et un mignon petit chat. Un film bien ancré dans la filmographie, et malgré tout certainement l’un des meilleurs.
Au fond, les losers des frères Coen, on les aime sûrement parce qu’on y retrouve tous un peu de nous. En plus, ils sont attachants et ils nous font rire. Et quand ils jouent de la guitare comme Llewyn Davis, alors là…
Cécile Lienhard
http://www.youtube.com/watch?v=9LwfTIvul4Y
One Comment
John Deuf
L’homme barbu qui a écrit Quai d’Orsay s’appelle Antonin Baudry, non Baudrier